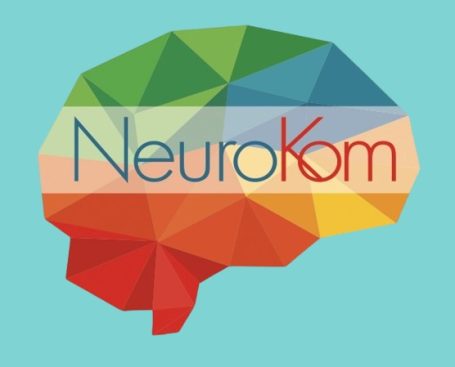Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine… (ou pourquoi notre cerveau préfère qu’on lui raconte des histoires)
Vous pouvez citer sans peine la réplique de ce film vu il y a dix ans mais vous avez oublié le contenu de la présentation d’hier ? Vous pouvez me raconter toutes les péripéties du dernier roman que vous avez lu et qui vous a tenu éveillé toute la nuit alors que votre dernière formation de finances publiques vous a perdu au bout de quelques minutes ?
Et c’est normal…notre cerveau préfère qu’on lui raconte des histoires. Pas seulement pour se divertir, mais aussi pour comprendre le monde, donner du sens à ce que nous vivons, et surtout… mémoriser. La science nous éclaire de plus en plus sur les mécanismes qui expliquent cette passion cérébrale pour la narration.
La sidération : nouvelle technique de communication ?
La sidération est un état émotionnel qui se produit face à un stress, qu’il soit physique ou psychologique comme un discours paradoxal ou extrême.
Elle repose sur l’effet de surprise, la confusion qui entraine l’inhibition temporaire des capacités de réaction chez l’interlocuteur. Il s’agit de court-circuiter la réaction immédiate pour imposer un message.
Comment les réseaux d’information influencent toutes nos vies.
Nexus de Y.N. Harari est l’un des livres les plus intéressants qu’il m’ait été donné de lire récemment et je considère que tout un chacun devrait absolument s’y plonger afin de mieux comprendre et réfléchir à notre monde et surtout à celui qui peut advenir.
Dans ce livre, Y. Harari retrace l'évolution des réseaux d'information, depuis les premières formes de communication jusqu'aux défis contemporains posés par l'intelligence artificielle. Il interroge le rôle de ces réseaux dans la construction des sociétés humaines et met en garde contre les dangers de l'IA sur nos structures sociales et politiques.
Neurosciences et discours politique : peut-on mieux comprendre l’impact des discours de D. Trump ?
Le discours d'investiture de Donald Trump, prononcé le 20 janvier 2025, a suscité de vives réactions, non seulement pour son contenu politique, mais aussi pour sa structure rhétorique et son impact émotionnel.
Il offre une riche matière pour une analyse neuroscientifique. En effet, en analysant un discours sous cet angle, on peut décoder comment des mots, des idées ou des symboles activent les émotions et utilisent les biais cognitifs, maximisant ainsi leur impact.
Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions
Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez consulter les détails dans la politique de confidentialité et accepter le service pour voir les traductions.